
Se mêler à la mêlée
Photo : Sac à procès, affaire Séguenaut, juillet 1699. Archives municipales de Toulouse, FF 743. Cliché Stéphanie Renard.
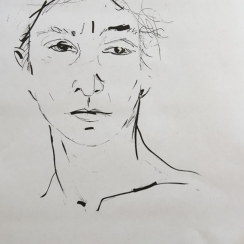
Karelle Ménine par Perrine Poget
Karelle Ménine, historienne et autrice pluridisciplinaire
* Géraud de Lavedan, archiviste, fonds anciens, Archives municipales de Toulouse.
** Cet échange prend place dans le cadre de la résidence de création menée par Karelle Ménine aux Archives municipales de Toulouse et au Théâtre Le Vent des Signes, financée par Occitanie Livre & Lecture et Toulouse Métropole via leur dispositif de soutien à la création en résidence.

Les capitouls de l'année 1437-1438, enluminure sur parchemin. Livre I des Annales manuscrites des capitouls. Archives municipales de Toulouse, BB 273.

Sac à procès, affaire Séguenaut, procédure du 30 juillet 1699. Archives municipales de Toulouse, FF 743 (en cours de classement). Cliché Stéphanie Renard.
Au coin d’une petite rue, il émerge d’une allée de platanes avec sa forme de navire, l’emmanchement d’un escalier de pierre, des airs de palais mais le flegme d’une maison tranquille. Dans le hall l’archiviste Géraud de Lavedan* attend. La première fois que nous avions correspondu**, je ne savais pas comment répondre à ses questions. Ce que je recherchais ? Rien. Et tout. Ce que je recherchais : c’était lui. Ce que lui voudrait me montrer, ce que lui trouverait utile d’extraire de la quantité folle de documents conservés dans son bâtiment. C’est ainsi que de cet homme discret et attentif qui gambade avec passion entre le XIIe et le XVIIIe siècle a surgi ce jour-là un élément immense. Dans son bureau, sur une table roulante, il avait disposé, remontées du sous-sol, quelques boîtes grises. Et il y eut d’abord le refrain.
Le rythme des phrases scandait la lecture. « Interrogée - Elle répond. Interrogée - Elle répond. » Dessous, se tenait la parole, qui contenait une promesse, celle sur laquelle toute une vie s’appuyait : la femme disait avoir dit la vérité. Le dossier l’affirmait : exhortée à mieux dire la vérité, a dit l'avoir dite. Comme de dire : je le jure. Mais il y avait les « si » : « si elle a », « s’il n’est vrai » ; mais il y avait les quand, les pourquoi et les sous-entendus ; et ainsi ce n’était pas une parole propre, sans surveillance ni bride : lors de son interrogatoire Catherine parlait sous bonne escorte et répondait aux questions autoritaires des capitouls, magistrats élus chaque année par les différents quartiers (capitoulats) de Toulouse. Et puisque « le pouvoir ne s'exerce pas, il se montre », le manteau, la robe et le chaperon montraient haut la fonction à Catherine qui (laissons faire notre imagination), habillée de nippes et serrant son panier, regardait de guingois ces êtres vêtus de manteaux rouges et noirs qui fouillaient les entrailles de sa vie.
Interrogée pourquoi elle est venue à Toulouse.
Répond qu'elle y est venue dans l'intention de s'y placer en qualité de fille de chambre.
Dossier après dossier, ce qui ressortait des pages écrites à l’encre noire sur papier chiffon que je consultais en cet instant c’était ça : la vie (souvent difficile) de petites gens, et leurs mots pour se défendre. « Répond et dénie » était-il écrit. Si Catherine était coupable, c’était d’être une femme pauvre. Les affaires se succédaient, d’autres interrogatoires, d’autres aveux, et ces paroles arrivaient depuis l’arrière-cour du droit et des inégalités en déroulant l’image animée d’un monde en portrait du nôtre où il s’agit souvent de faire comme on peut. On commettait de menus larcins pour vivre, on se déplaçait pour vivre, on se dépatouillait avec le système, manège face auquel la justice, depuis des millénaires, tente une cicatrisation. En une plainte qui ne se voulait pas une aumône se formulaient successivement des demandes de réparation : qui accusait d’avoir été volé, et qui refusait d’être accusé, et devant nous s’ouvraient à l'infini des affaires de mœurs, de vols, de crimes, avec parfois au détour d'une procédure, comme en ce 12 mars 1740, sous un chant d’insultes, un éclat : « que le diable de ton corps face cabanne ».
Mais sur la table roulante de Géraud, une de ces affaires avait la forme d’un objet. Les feuilles des magistrats pliées en deux avaient été rangées dans un petit sac de jute qui leur servait de jupe jusqu’à la taille. C’est ainsi qu’elles étaient classées : une fois closes, les affaires étaient mises dans le sac. Puis elles étaient rangées. Puis, au fil du temps, oubliées. Plusieurs milliers de ces petites pièces mi-tissu mi-papier sont ainsi passées entre les mains de Géraud qui, patiemment, les reclasse, les inventorie, les étudie. De l’écriture manuscrite aux pleins et courbes particuliers, il a fait territoire. Il sait traduire, et traduit. Il est de ces archivistes qui partagent.
Et c’est toujours un acte de résistance, l’acte de création, disait Gilles Deleuze. Et l’acte d’écrire se tient tout entier dans cette offrande de pouvoir résister à ce qui échappe. L’écriture peut (se doit de) réparer, au sens premier du mot latin reparare : préparer à nouveau. Si l’archive est ce fragment de journée, cette ruelle, ce document, si elle replace dans la course des jours ce que nous avions délaissé, un arbre, un ruisseau, une lettre, un bol, un jouet, tout ce qui a un jour rencontré notre souffle et est resté en alerte, l’écriture peut monter le volume de ces voix qui ont pensé, formé, dit, et dont le canal de transmission a été morcelé, mais sans être interrompu. Il suffit, comme au rugby, de se retourner tout en continuant non une effrénée course en avant mais bien ce chemin collectif où chacune/chacun est engagé par sa seule présence au monde. Il suffit de se mêler à la mêlée. L’écriture depuis l’archive permet d’agrandir cette cartographie du lien et participe à la désaliénation indispensable, seule capable de nous rattacher au Vivant. Ainsi, ce jour-là, depuis le petit bureau de Géraud, des retrouvailles entre un peuple se débattant avec les nécessités de ce XIIe siècle et un peuple se débattant avec celles d’aujourd’hui eurent lieu et a émergé l’esquisse d’une installation, d’une interprétation, toute chose qui puisse éclairer ces voix et soulever la poussière. Replacer l’archive par devant nous, voici ce à quoi mon travail s’attelle. J’y rencontre des réponses qui me grandissent. La délicatesse est de ne pas se servir d’elles, mais d’être à leurs services. Au bout de l’allée le bâtiment va bientôt fermer. Fumant une cigarette, Géraud dit : « Alors, à demain ? ». Et c’est un cadeau supplémentaire que fait l’archive, que d’obliger à prendre son temps.
